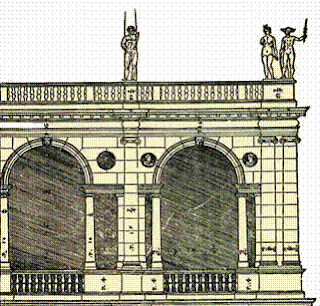L’ouvrage collectif présente chronologiquement l’évolution
de la condition ouvrière à partir d’études depuis des lieux très divers comme
il se doit dans un département qui va du Rhône aux Alpes.
Ainsi les tailleurs de pierres à Montalieu dans le Nord Isère illustrent le passage du statut d’artisan à ouvrier au XVIII° siècle alors que la pluriactivité était la règle dans les montagnes de l' Oisans :
paysan l’été, colporteur ou mineur l’hiver.
Ainsi les tailleurs de pierres à Montalieu dans le Nord Isère illustrent le passage du statut d’artisan à ouvrier au XVIII° siècle alors que la pluriactivité était la règle dans les montagnes de l' Oisans :
paysan l’été, colporteur ou mineur l’hiver.
La fabrication des toiles du côté de Voiron occupait les
familles paysannes, pendant que les peigneurs de chanvre au début du XIX° siècle
en milieu urbain se devaient d’être mobiles.
Au XIX° siècle, Vienne, où se tissaient les draps
Renaissance fabriqués à partir de chiffons mélangés à de la laine, était
« un centre révolutionnaire redoutable ».
Le tissage de la soie débordait « à partir de la
matrice lyonnaise » dans le bas Dauphiné et les activités papetières du
Grésivaudan à Rives se développaient depuis 57 établissements.
Les vagabonds, venant en particulier de la région parisienne
avec la fin des travaux haussmanniens furent attirés dans la région. La France traversait une crise importante, mais la « houille blanche » a
permis le renouvellement de l’industrie dans la chimie ou les cimenteries.
Tandis que 55 grèves de 1870 à 1914 ont agité Voiron, les
syndicats regroupant en particulier les femmes se sont multipliés. Elles
travaillaient jusqu’à 60 heures par semaine, pour 1,60 Franc par jour contre 2 Francs pour les hommes et 0,90 Franc pour les jeunes filles.
Certaines logeaient dans les « usines pensionnats » où s’exerçait
fortement l’influence de l’église.
Les conditions de vie et de travail des ouvriers de la
Viscose pendant la seconde guerre mondiale étaient dantesques :
tuberculose, saturnisme, dénutrition.
Sur 288 accidents du travail en 1944, 78 ont été dus à des glissade sur le sol
détrempé des ateliers. Le manque de gants en caoutchouc provoquait des lésions
cutanées.
Chez Neyrpic, les braseros sont remplacés en 1948 par des
équipements plus efficaces. Dans ces années là l’entreprise déclarait une
trentaine d’accidents du travail par mois.
Les témoignages sont trop rares à mon goût, comme celui de
cet ouvrier de la rive gauche de
l’Isère :
« Je regrette
l’ambiance des petits bals parce que ça permettait aux gens qui ne dansaient
pas de sortir, de s’asseoir »
ou ce souvenir ambiguë des cantonnements d’étrangers à
Salaise-sur-Sanne :
« Moi les
cantonnements, je suis fier d’y avoir vécu, ça m’a construit. Mais certains ne
veulent pas en parler, ils considèrent qu’ils ont réussi. »
La classe ouvrière n’est pas uniforme et les travailleurs
algériens sur les chantiers étaient relégués. Pourtant des acquis sont arrachés
en 36 par l’action des syndicats et les compétences sont mieux reconnues,
favorisées par les écoles professionnelles ou d’entreprises, les cours du soir.
La mise en place des comités d’entreprise institutionnalise
une citoyenneté ouvrière qui dépasse le paternalisme à l’œuvre par exemple dans
« Le trait d’union », journal d’entreprise édité dans l’entre deux guerres.
Dans cet ouvrage à l’initiative d’un musée, il n’est pas
étonnant que soient évoqués les mouchoirs commémoratifs de Bourgoin qui
servaient en particulier à essuyer les boules lors des tournois. Une dernière
création représente un pompier qui embrasse la « Fanny » dont un
baiser sur ses fesses nues était réservé aux perdants. Le responsable du musée
matheysin met en valeur les oeuvres des mineurs qui se sont multipliées depuis
qu’ils sont à la retraite.
Vers la fin de ces 168 pages, la synthèse est efficace qui
relie tous les articles aux tonalités universitaires scrupuleuses qui
alourdissent parfois le propos. Cependant la reprise d’une citation de Jean Paul
Molinari, sociologue, peut dispenser d’un résumé.
« La classe ouvrière
n’est plus ce qu’elle était à l’apogée de son nombre (1975) comme de sa
puissance sociale, de même qu’elle n’est plus ce qu’elle avait été, dans le
temps où l’illusion de son essence valait science de sa réalité et foi en son
avenir. »